
Elle tapait dans ses mains…


16 commentaires
Quand je comprends qu’il est bien tard, que les années qu’il me reste n’en finiront plus de se jeter sur moi pour mieux m’éviter, que je sens les regrets sédimenter au fond de mon cœur, je ne suis bien que là, arrimé à ma chaise, sur mon tapis de bambou, à distance de mon chevalet d’un demi bras.
Cinq litres de white spirit en bidon sous la main gauche, mes couleurs dans leurs bacs sous la droite, l’essence et l’huile dans leurs godets, les pinceaux en bouquet dans leurs pots, le front sous la lampe et ma palette chargée sur mes genoux j’attends.
Je me débarrasse du monde comme il se débarrasse de moi.
C’est un processus, pas même une fiction.
L’impensé, à coups de lignes et de masses, s’ordonne, trouve sa cohérence, se dévoile. C’est un mouvement inquiet qui cherche son apaisement par un saisissement. Je ne veux rien sinon glisser hors de moi, guidé confusément par la vibration des couleurs, par l’ivresse d’un geste délié, d’un trait retenu. Je suis dans la pâte que j’écrase sur la trame de la toile, dans la soie du pinceau, dans la main qui porte mon désir, dans l’image qui émerge.
Je me plais là, infiniment paisible, en retrait des pensées, à camper à l’abri des mots, baigné dans la sensation intense d’être au bon endroit, au bon moment.
Ailleurs je perds mon temps.
Un jour loin de soi
Un jour monochrome, mat, plat comme un plat
Sans histoire, ni relief
Sans creux, ni bosse
Sans cri, ni couac
Un jour raide
Qui rebute et qu’on clabaude
Un jour sans faux-plis, ni faux-plat, ni faux-pas
Un triste plat du jour
D’un jour sans appétit, sans estomac,
Sans mordant, sec et dévitaminé, sans saveur,
Ni service complice, ni ferveur qu’on place
Dans rien
Un jour loin de soi
Sans sketch-book, ni bloc-notes, ni bâtons de graphite
Délivré des livres et des brosses
Alangui dans de beaux draps, sans bras blancs de femme
Sans room-service, ni café, ni jus d’orange, ni rideaux rabattus, ni contre-jour
Loin des frôlements de presque, des traitements de textes
Remuer non, rester là, serti d’ennui,
À l’abri des hommes
Éboulé, aboulique
Bailler ballant sans pitch, sans accroche, sans pêche
Petits plats dans l’écran des tablettes aux pétillants pixels
Des plans sans éclats, sans clinquant, s’évaporent
Les heures sans contours, sans attente, s’envasent,
Les appels en souffrance, les notifs et les alarmes désarmées
Les à tu et à toi et tout le tralala se taisent
On songe aux sentiments falsifiés
Sans y croire, sans y cuire, sans s’y fier
Mais aussi aux romans qui mûrissent, rancissent, se décolorent
Aux dessins qu’on avorte par la pensée
A tout ce qui ne sera pas
Saoul de térébenthine, de mots crus, de bruine, d’absence
Coffre-cœur inviolable caché dans un ourlet de chair rouge
On ne pleure, ni ne prie, ni ne plie, ni ne pense
On peine
S’en retourner à soi demain
Soluto, novembre 2017
Le 9 novembre dernier Jean-Claude Lalumière (clic) écrivait le billet que voici sur son blog :
Chaque soir, ou presque, depuis six mois maintenant, je raconte en dix lignes au moins, parfois vingt, rarement plus, la journée qui vient de s’écouler. Presque chaque soir. Même en ligne, l’exercice reste solitaire. J’ai parfois l’impression de boire tout seul au comptoir. Je suis nostalgique d’une époque où internet n’avait pas encore inventé les blogs et où l’expression y était encore collective, comme avec Antidata, avant que la revue ne deviennent maison d’édition. Pour rompre cet isolement, j’ai décidé d’ouvrir ce blog à des invités, de leur demander de raconter une journée de leur choix, Une journée particulière, inoubliable, ou au contraire banale, comme une autre, une journée imaginaire, rêvée, idéale, de cauchemar, une belle journée, de solitude ou entre ami, une journée à oublier, qui ne mérite pas d’être notée, la dernière, la prochaine, sous le soleil ou sous la pluie, à la mer, à la campagne, une journée de travail, de vacances, de farniente, de shopping, de fête ou même une nuit. A eux de voir. Leurs journées viendront s’ajouter aux miennes, sans contrainte (ils sont libres de produire ce qu’ils veulent : texte court ou long, poésie, chanson, vidéo, photos…) Une sorte d’auberge espagnole, d’atelier d’écriture, de création permanent… (…) https://jclalumiere.blogspot.fr/
Puis il m’invita à y aller de ma journée… Je vous ai donc recopié mon poème, ma participation, ma réponse à l’invitation (sorte d’Invitation au Voyage – sur place – pour ma part)…
 Lavis d’encre de chine sur une feuille Canson 21 cm x 29,7 cm. Août 2015
Lavis d’encre de chine sur une feuille Canson 21 cm x 29,7 cm. Août 2015De l’âpre râpe, qui nous occupait tant, il fût à peine question…
J’arrivai mal lavé de mes rancœurs, fâché d’être où je n’aurais pas cru, portant mon arriéré et mes désirs déboités. Les ajustements à coups de marteau brûlent du désir de plaire : que de poses, d’effets, de pauses et de faux plats.
Sur le grand pont de bois le temps était aux jus de fruits. Nous avons bu du vin, de la bière. Ses oreilles, qu’une aile de papillon éventait à l’italienne, chauffaient comme des quartiers d’oranges sanguines. La mer d’acier brossé était affreusement plate et l’ombre bleue des parasols nous évitait. Nous cheminions, à demi-éblouis, au bord du flou, à la myope. Le vers m’était venu en la voyant apparaitre. Je devais le couver depuis longtemps.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse.
La lumière transperçait son corsage. Elle était magnifique, plus en traits qu’en volumes.
Je rêvais donc aussitôt de grand deuil.
Comme il fallait sourire nous devînmes sérieux. Je pris la mouche pour m’envoler un peu. Je n’allais pas bien loin : l’art de la conversation ne se maitrise qu’avec indifférence. Ah, si l’on pouvait s’éloigner de soi. Le moindre égard corrompt tout, bride l’irrévérence, leste les élans. Badiner suppose qu’on cultive la part de mépris due à chacun. Nous n’étions pas à la hauteur et je m’en accusais.
La conversation savonnait. Je lui pardonnais tout par facilité. Pour ne pas paraître cuistre, à propos de verres à pied, je me retins d’évoquer Deleuze. Plus tard je pensais aussi à l’amie Nane de Toulet.
A la fin de notre entretien je la raccompagnai jusqu’à son canot. Son grand cou supportait un sourire composé. Mon pas était égal au sien, mon souffle peut-être aussi. Elle marchait droit. Agile et noble, avec sa jambe de statue.
J’étais triste d’être déçu, de n’avoir pas su nous bouger d’un iota, de ne pas l’avoir reconnue. Qu’espérais-je ? Voulais-je vraiment boire, crispé comme un extravagant, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue ?
Nous n’avons rien tissé, rien retenu. Nous avons tricoté lâche et tout a filé.
Je n’ai pas vu germer l’ouragan.
La couverture du dernier ouvrage de Schiffter, Le charme des penseurs tristes, a tout de suite retenu mon attention. L’auteur de la photo, Nori, a su capturer, au fond d’une sorte d’entonnoir de lumière, un personnage solitaire descendant vers la mer. Un individu minuscule avançant sur une route déserte entre un château et la végétation, le masculin et le féminin, la culture, la nature… Toutes ces choses qu’on ne manque pas de projeter pour peu qu’une image somptueuse vous résiste un peu.
C’est en renonçant à examiner la photo dans le détail, et en prenant un peu de recul, que s’est levé ce pubis de lumière… Je n’ai pas pu résister. J’ai, à partir de cette photo, réalisé le montage ci-dessus.
Schiffter n’en a pas été fâché puisqu’il l’a publié sur son blog.
Vous pouvez vous lancer dans ce livre. Si d’aventure il n’était pas pour vous, vous n’y comprendriez rien et en sortiriez indemne. Mais à l’inverse, si ce texte vous trouve, il déploiera son charme et vous touchera profondément. Peut-être même durablement.
Je vous livre l’une des phrases de l’auteur que j’ai recopiée afin de ne pas la perdre trop vite « Le sentiment tragique de la vie répugne à l’esprit de sérieux, sa parodie vulgaire. »
Qui dit mieux?
http://lephilosophesansqualits.blogspot.fr/
Montage à partir de la couverture du dernier livre de Schiffter
septembre 2013
…
J’ai surtout compris que je ne vous laisserais pas filer sans tenter d’échanger quelques mots avec vous. Je voulais connaître le son de votre voix…
Je suis un pleutre. Ma gorge se serre vite, je tremble souvent, parfois je crains que mes jambes ne se dérobent. Mais je sais aussi qu’il faut être courageux quand la situation l’exige, que les plats ne repassent pas, qu’on peut se dessécher à force de regrets. Avec l’énergie du timide acculé j’ai marché vers vous. Vous me tourniez le dos. Je cherchais une phrase à vous dire, mille compliments naissaient et mouraient de ridicule dans ma tête échauffée. A mesure que je me rapprochais de vous je perdais mes moyens. C’est dans ce contexte que ce fichu chariot m’a échappé, qu’il est venu vous heurter… Quel bel acte manqué. Pardonnez-moi encore… Pour ne pas vous perdre trop vite j’ai inventé n’importe quoi… Une tâche, une ombre, un trou dans votre manteau… Il a fallu que ce gros bonhomme infâme se mêle de notre histoire au moment où je retrouvais un soupçon d’aisance pour tout fiche en l’air ! Mais peut-être suis-je injuste… Peut-être même devrais-je le remercier. Sans lui je ne serais peut-être pas là à vous raconter ces histoires qui doivent vous faire bien rire…
— Je ne ris pas ! dit-elle plus vivement qu’elle ne le voulait.
J’ai fait celui qui n’avait pas entendu et j’ai continué. Je tenais bien mon public, il fallait en profiter.
— Voilà, vous savez tout. Enfin, presque tout… Le reste n’est pas dicible. C’est un mélange de joie et d’inquiétude. La joie d’être arrivé jusqu’à vous, d’avoir su vous confier ces quelques émotions avec lesquelles il va falloir maintenant que vous vous débrouilliez. Je ne me fais pas de soucis : les femmes savent très bien ranger tout ça sous leur mouchoir. Mais aussi d’inquiétude, donc… Car je vais prendre mon taxi, rentrer boire mon champagne seul et vous perdre pour toujours…
Extrait de Glaces sans tain Ed. Le Dilettante
Tous les renseignements sur mon livre sont ici: http://www.ledilettante.com/livre-9782842637675.htm

La mer longée jusqu’à-Sainte A, la grille, la cloche et les trois marches du perron. La porte gris perle, la salle d’attente comme un refuge. Treize années de rendez-vous. Toujours le jeudi, toujours à dix-sept heures et vingt-cinq minutes, exceptés six semaines dans l’année, deux l’hiver, quatre l’été. Mes rendez-vous manquants calés sur ses congés. Le distributeur de la Société Générale de la place des Halles, les billets retirés, pliés, glissés dans la poche arrière droite de mon jean, bientôt dans sa paume. Colère, reconnaissance, c’était selon. Ses ongles vernis repliés sur mes heures de travail devenues abstraites.
Salle d’attente donc. Papier peint bleu pastel, fauteuil unique, en rotin, défraichi. Au mur, à gauche, un poster alignait des dessins de nœuds marins, à droite une petite vitrine présentait, épinglés, ces mêmes nœuds fabriqués en cordelette. Chacun d’entre eux était souligné d’une étiquette avec un nom (nœud de vache, nœud de galère, nœud de Carrick, nœud de cul-de-porc, nœud de tête-de-Maure… Je me souviens de presque tous…). Par terre traînaient des livres pour enfants.
Elle venait me chercher, un élastique ou un bout de ficelle en main. Avec à chaque fois le même sourire, la même sollicitude et une même distance. Je m’allongeais sur le divan damassé, rouge et or, après avoir retiré mes chaussures et mes chaussettes car j’ai toujours aimé avoir les pieds nus.

Parler. Etre dans sa parole. L’habiter enfin.
Des mots, des mots perdus, éperdus, insensés. Des phrases mortes, dites par d’autres, déposées dans ma bouche. Des étrangetés moisies qui ne me ressemblent pas. Le vertige des failles entrevues. Des rêves dévidés. Des bribes mal couturées. Ses interventions, toutes vécues sur le mode de la violence et du doute. Que sait-elle que je ne sache ? Que tais-je qu’elle contienne encore mieux que moi ? Mais aussi ses gros sabots, toute sa morgue, ses poses (le feulement de ses collants quand elle croisait ou décroisait les jambes derrière moi) et sa suffisance. Sa traque. Ses tentatives de levée de pensées prétendument incestueuses, mes hypothétiques pulsions meurtrières. Mes ricanements.
Flash. Un jour je me redresse sur le divan, me retourne vers elle, mets mes mains grandes ouvertes en renfort de mes oreilles et, saisi d’une inspiration, lui fais le lapin de Chantal Goya en la regardant droit dans les yeux. Pour voir, donc. « Vous ne pouviez pas ne pas le faire. » Sans doute.
Assez joué. Raccourcissement du temps des séances et augmentation de leur coût. Pour que « je me mette au travail »… J’aurais dû rire. Mais mon assujettissement, mes allégeances… Mon investissement et mon énergie me privaient de tout esprit critique. Les séminaires, les lectures impossibles, la théologie lacanienne et l’angoisse, obstinément là… Mon addiction aux séances, ma soumission, la montée en puissance du dégoût. La souffrance de l’emprise.
Me reviennent deux anecdotes qui se répondent. La première en début de cure. Je lui offre le journal de Michel Leiris. « Ici on ne s’attire pas de bonnes grâces par des offrandes » me dit-elle. Elle refuse même de toucher le paquet cadeau que j’avais fait faire à la Galerne et ne saura jamais ce que je lui destinais. C’était bien répondu. Douze ans plus tard je me trompe dans le paiement d’une séance. Un billet de cinquante euros s’est glissé dans les billets de vingt. « Vous vous trompez d’endroit! Ici le « petit cadeau » n’est pas de mise » Elle est risible. Enfin risible! Je veux finir la cure. « C’est dommage, ça commençait à bouger… » me dira-t-elle.
Dernière séance. Je me fais plaisir. Je m’approche d’elle et je l’embrasse. « Oh ! s’écrie-t-elle, un réel » Elle ne recule pas.
C’était il y a longtemps. Tout ça me parait bien loin, confus comme un songe. Je ne comprends plus rien à mes peurs passées, à toute cette servitude volontaire. Aperçu récemment sur la promenade de la plage je suis allé au devant d’elle en souriant. C’était la première fois que je la revoyais. Elle, qui me semblait naguère hors du temps, m’a paru vieille et définitivement sortie du champ du désir. Nous avons parlé un peu. J’ai voulu savoir si je pouvais dessiner et écrire sur la cure. Elle m’a répondu avec indifférence que je l’avais payée et qu’elle m’appartenait. Son désengagement m’a contrarié. Par une curieuse association je me suis alors demandé si elle avait gardé sa passion pour les nœuds. En tout cas, elle en avait toujours la tête… Enfin, ce n’est pas ce que je voulais dire…
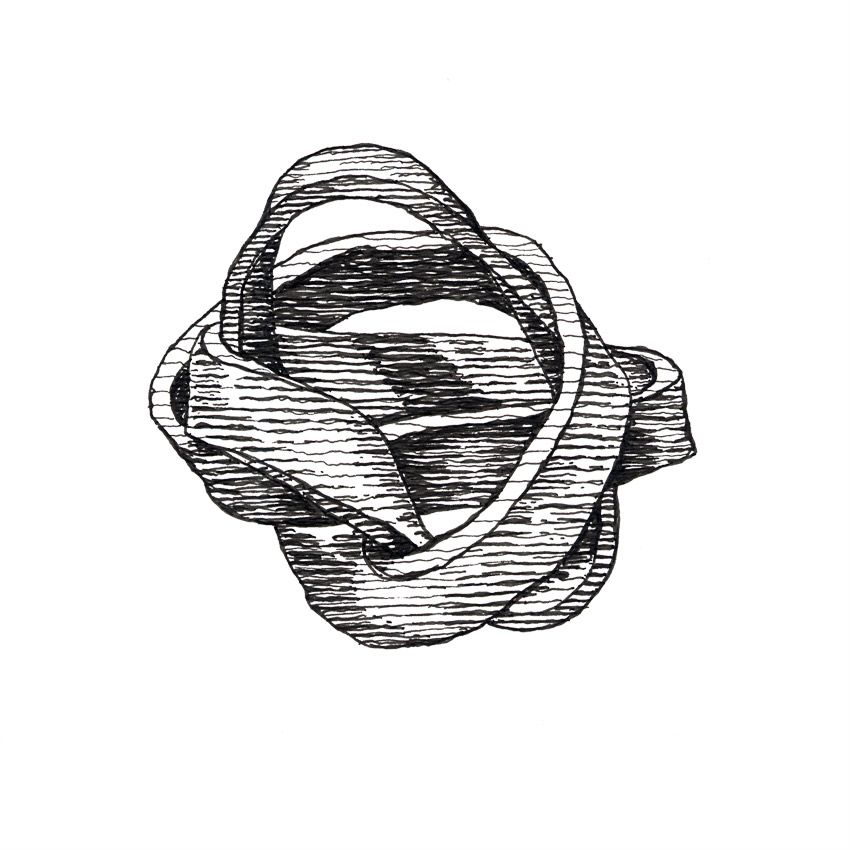

Ça n’enchantait plus personne de faire un détour pour aller les chercher, les trois frangines. Tout le monde ne court pas après ce genre de courses. J’ai des collègues qui répugnent à faire dans le moyen trajet, surtout maintenant qu’on peut plus bricoler les compteurs. Moi, j’ai pas les moyens de chipoter sur le boulot, j’ai encore des kilomètres à faire pour amortir la licence. On m’avait prévenu au central qu’elles n’étaient pas commodes mais, bonne pomme, je m’y étais collé, sans doute un peu naïvement. Seulement voilà, dans cette campagne cauchoise où tous les chemins se ressemblent par pluie battante je m’étais perdu en route. Pas beaucoup, remarquez ! Mais bon, j’avais, j’avoue, ma petite demi-heure de retard…
Quand je me suis garé le long de leur foutue longère, les trois grâces, qu’on aurait dit plantée là depuis des lustres, m’ont jeté un œil noir ! Si noir que ça m’a foutu les foies ! Et j’ai bien cru qu’elles allaient me buter quand elles se sont approchées du bahut… Pendant tout le trajet qui nous emmenait à Bonne-Nouvelle, où le fils d’une des teigneuses était incarcéré, elles m’ont pas dégoisé un mot… Toutes les trois à l’arrière, le sac sur les genoux, en regardant droit devant elles, elles chuchotaient. On aurait dit qu’elles préparaient un casse de PMU dans une rue passante. Quand je croisais leur regard dans le rétro je me sentais en faute. J’avais même la trouille d’être mouillé malgré moi dans leurs drôles de combines. Pour me distraire j’ai voulu mettre des chansons nostalgiques à la radio mais la plus vioque a dit « ferme ton zinzin et regarde la route… » J’ai plus moufté.
A Rouen je les ai déposées devant la grande lourde noire de la Maison d’Arrêt. Celle qui n’aimait pas la musique a dit « Tu reviens nous chercher dans une plombe. Précise. Tu ne recommences pas tes fantaisies ! » Je les ai laissées sur le trottoir à côté de femmes plus jeunes qui leur adressèrent aussitôt la parole. Elles attendaient toutes leur temps de parloir…
J’ai même pas osé m’éloigner du quartier (une heure ça passe vite) de peur qu’elles me foutent un contrat sur la tronche, ou qu’elles bavent à leur progéniture à propos de mes manquements horaires. Alors je suis allé siffler une paire de mousses dans un bar voisin appelé ironiquement Le Violon. J’ai aussi fait cinq morpions et deux Vegas. J’ai paumé. C’était décidément pas mon jour…
Alors que j’arrivais à l’heure dite, elles jaillissaient sur le trottoir de la prison et fonçaient déjà sur le bahut. « On a failli attendre !» a dit l’une, « En voiture Simone… » a fait l’autre, « Il tiendra ! » a lâché la troisième. Elles étaient ragaillardies mes trois vieilles. Elles lui avaient trouvé bonne mine et de l’éclat dans l’œil! Il était aussi question de « redresser sa bonne femme, une donneuse, une morue, qui faisait un peu trop sa suceuse avec les Schmidt!… » J’ai cru comprendre que la môme avait suspendu sans prévenir ses visites, mais, bien sûr, je n’ai pas demandé de précisions… Je me suis contenté d’avoir l’oreille flottante…
Puis, sans crier gare, il a été question des Chiffres et des Lettres. J’ai saisi l’allusion et j’ai écrasé le champignon au mépris des limitations de vitesse. Comme quoi on devient vite hors-la-loi… Mais je crois en effet qu’elles n’auraient pas toléré de rater le début de leur émission favorite…
Chère Marcelle,
Vous voir chez vous… J’en avais le désir. Cette affaire-là aussi est maintenant derrière nous…
Sur le pas de votre porte vous m’avez paru plus grande que d’habitude. En ce début d’après-midi le noir et la lumière du jour vous allaient drôlement bien. De douces appréhensions flottaient. Un essaim de petites émotions tourbillonnait si vite qu’il échappe encore à toute mise en mots, en pensées (et puis, je n’ai pas envie du tout d’aller fouiller là-dedans. C’est bien plus troublant de laisser tout ça me bousculer encore un peu…) Chez vous ! C’était au-delà de ce que j’imaginais pouvoir m’autoriser il y a peu encore… Bien sûr, je me suis senti gauche (le pompon ? quand j’ai mis le chinois à thé sur votre mazagran ! J’avais bien vu que vous buviez un drôle de café, mais j’avais l’esprit occupé à je ne sais quelle idée, envolée maintenant…) Oui, gauche et maladroit… Mais malgré tout je me sentais bien à ma place. Je veux dire que j’étais là où je devais être à cet instant précis… Puis cette visite guidée, ce tour du propriétaire (euh non, du locataire…), mes hésitations au seuil de votre chambre, que vous avez senties, vos paroles qui m’ont parfois fait sourire, votre façon de passer devant moi pour descendre l’escaler de bois et le bruit de votre grande jupe, quand vous l’avez attrapée, afin qu’elle n’entrave pas votre descente… Notre couplet quasi-rituel, mais justifié, sur les difficultés de nos boulots respectifs, puis enfin notre vitesse de croisière… Les bouquins, les photos de Plossu, les mots calligraphiés, les dessins… Tout ce qui nous a précédé…Qui était là avant nous… Qui nous a lié l’un à l’autre…Que nous avons rattrapé… Vous, plus près de moi, et les voix mieux posées, et les pages ouvertes, offertes… Nous (je) aurions pu épuisé votre bibliothèque entière…
Je ne me lasse pas de vous. Ça me pose gentiment question, mais pour autant que ce puisse être un acte volontaire, j’ai décidé de ne pas m’en soucier autrement que pour m’en réjouir… vous voilà prévenue… Et d’ailleurs nous avons bien cherché cette étrange situation. Voilà, j’ai voulu vous faire ce petit mot ce soir, parce que demain il m’aurait échappé, peut-être même serait-il devenu impudique… On est si vite rattrapé par soi-même…
« A tout bientôt » Je vous embrasse…
Pour eux mon temps ne compte pas. La secrétaire m’a renvoyé à mon bureau et m’a signalé qu’elle me préviendrait de leur arrivée. Évidemment ils avaient trois quarts d’heure de retard. Ils ont toujours trois quarts d’heure de retard. J’ai relu mes notes, j’ai tortillé quelques trombones, j’ai pris connaissance des derniers mails. Je suis retourné aux toilettes. Enfin la secrétaire a appelé. J’ai pris plutôt les escaliers et j’ai vu qu’on avait changé le panneau du plan d’évacuation du bâtiment. Accréditation oblige. Elle m’a mené jusqu’au salon du directeur. Ils étaient là tous les trois et le gars de la DRH avait par avance dégrafé son col. Son nœud de cravate était mesquin. Ils prenaient un café dans des tasses de porcelaine blanche. Un sucrier art déco contenait des petits pavés de sucre roux. J’ai déballé ma salade, motivé des créations de budgets pour des postes intermédiaires, suggéré des redéploiements. Tous les six mois on me fait le même coup. Tous les six mois, comme à d’autres, on me fait plancher sur des projets hautement hypothétiques. J’obtempère docilement et je leur ponds des écrits comme on fait des cocktails ; avec une dose de ci, trois doses de ça et une pincée de trucmuche.… Ils m’ont écouté sans rien dire, assez distraitement d’ailleurs. A un moment le principal du département m’a demandé si je voulais moi aussi un café. J’ai dit oui parce que j’en avais terriblement envie. Il en a commandé un par téléphone à la secrétaire.
Elle l’a amené en moins d’une minute, sur un petit plateau, dans un gobelet, avec un sucre emballé et une cuiller en plastique. Je l’ai bu rapidement et j’ai écrasé doucement le gobelet. Ils m’ont encore posé deux ou trois questions, celles précisément que j’attendais, puis ils m’ont remercié.
Quand je suis ressorti de là, j’avais à nouveau cette douleur à l’épaule qui sait si bien ruiner mes week-ends.
…plus tard, je comptais les maîtresses, plutôt que les moutons…
c’est incroyable par ici… merci
> Et alors, cher Hub, vous comptiez jusqu’à combien? NON! non… Ne répondez pas à cette indiscrétion, je regrette déjà de vous avoir posé la question… Merci de vos passages en tout cas…
> Soyez la bienvenue Agathe… Ce qui me parait incroyable, c’est que vous soyez arrivé jusqu’ici et jusqu’à moi… Nos univers sont si différents… Cependant, ou peut-être à cause de ça, votre passage me ravit… Revenez vite…
Elle est belle, certes, mais beaucoup plus vieille… Moi qui ai « subi » quelques regards rougissants de mes élèves, garçons de 17-18 ans (j’en avais moi-même 23-24…) au début de ma courte carrière de prof, je trouvais déjà cela un peu gênant… Surtout, en pensant à mes propres années de lycéenne et à nos amours éperdues pour certains de nos professeurs… Dans ce sens, quoi de plus « normal »?…
C’eût été une bêtise à mon avis…elle profitait de ta passion pour elle pour en plaisanter avec ces collègues.
Une égocentrique narcissique…tu aurais été bien inspiré, avec une chieuse et sans tes parents!! La nature est bien faite. Bonne suite !
C’est super beau! J’aime!
Quel beau mélange d’illustration et de texte.
Et pour enrichir le débat, un souvenir personnel. Elle s’appelait Mme T. et m’enseignait l’anglais. Quand elle tapait dans ses mains, j’étais mort de peur et je n’étais pas le seul. Il faut dire qu’elle incarnait très bruyamment l’improbable croisement d’un rhinocéros nain (pour la rigidité massive) avec une loutre (pour la pilosité faciale). Nicole, sa fille, était en classe avec moi et son évidente hérédité m’empêchait d’avouer publiquement les fantasmes érotiques que sa génitrice m’inspirait. En fait, jusqu’à ce que les films d’Arts et d’Essai nippons me rassurent un peu, je vécus honteux de mes pensées sadiques. Chaque soir de cet année là, je remerciai Dieu qui m’avait donné pour mère un être visiblement féminin, proportionné et discret. Alors que Nicole, elle, devait rêver d’être adoptée par Eva Braun. Ceci dit, what a good teacher she was !
> Oh chère Flora, je suis bien d’accord avec vous… Rien d’anormal dans ces amours enfantines et éperdues… Juste une petite erreur sur l’objet du désir. Et encore… La folie eut été que cette formidable femme (voyez, on ne guérit jamais..) ait répondu de manière ambigue à mon attente, qu’elle se soit servie de son ascendant sur moi pour me lanterner… Au contraire, je crois qu’elle m’a beaucoup apporté… Cette histoire n’a rien à voir avec la vôtre, où à l’évidence les enjeux pouvaient être plus troubles… D’ailleurs, j’en aurais aussi à raconter à ce sujet! un jour peut-être…
> Vous vous emballez mon cher Yal! Une égocentrique narcissique! pour sortir aussi sec l’artillerie lourde et les mots qui font mal, on sent que vous avez dû morfler! Elle était mimi comme tout, et pas moqueuse pour deux ronds! Ses plaisanteries étaient salutaires, elles permettaient de nous remettre chacun à notre place… La grâce je vous dis, la grâce! (et puis d’abord je la défendrais jusqu’au bout…)
>Merci Magali… Votre commentaire, qui parle d’amour, est en accord avec mon texte… Au plaisir…
>Pauvre Klaudandreson… Comme vous avez dû souffrir d’étre tous les jours au zoo… On a beau dire, les conflits oedipiens, ça travaille l’homme! ça se gère à l’arrache, au gré des circonstances… Pour ma part, dans les dégâts collatéraux, j’ai perdu la foi… Franchement, ça aurait pu être pire…
Je vous renvoie tous à ce petit texte, écrit il y a quelques années, et dont le dessin s’est perdu dans les limbes de la toile…
http://soluto.over-blog.org/article-5308866.html
Il s’agissait déjà d’elle… à l’époque j’avais abordé le sujet de manière plus détournée…
> merci à tous de vos visites… Elles me font grand plaisir…
Je viens de chez la Faune et la Flore (où je suis souvent). Comme je l’ai écrit chez lui, j’aime beaucoup vos dessins.
je n’ai pas le souvenir d’avoir été amoureuse d’un seul de mes professeurs. Si ce n’est d’avoir été troublée (comme on peut l’être à 15 ans) (c’est à dire assez assez bécassement) par mon professeur de maths de seconde. Il était jeune et portait des jeans et des T-shirts Mickey ou rock sous ses chemises blanches. Il se glissait dans les rangs de la classe lors des devoirs sur table à la recherche de gauchers (étant gaucher lui-même) en leur murmurant : « un jour, toi et moi nous referons le monde à notre mesure … » (ce qui le jour où il me l’a sussuré dans les cheveux m’a fait beaucoup rire et rougir)
En Primaire, je n’ai eu pratiquement que des maîtresses (comme on disait …) Un seul instituteur. Ce qui avait provoqué bien des questions et des émotions à la rentrée : « nous allons avoir un maître … mais c’est comme un maître ?? est-ce que ça crie ? est-ce que c’est méchant ? est-ce que c’est bien ? ». Il s’est révélé charmant et passionnant. Un homme que j’adorais d’une affection débordante mais non d’amour. Il nous a fait travailler sur les atrocités de la seconde guerre mondiale, réfléchir sur la peine de mort, découvrir le fantastique Molière d’Ariane Mouchkine, la beauté de la poésie d’Appolinaire. J’avais 8 ans. Il s’appelait André.
Ce thème que vous nous suggérez ravive au plus profond de nous certains souvenirs (pas si cachés que ça !), à en voir les différents commentaires…. Et oui, l’école primaire avec ses maîtres et maîtresses, et les premiers émois amoureux qu’ils ont pu susciter chez certains d’entre nous.
Moi c’était un prof de sixième de transition( pour les plus jeunes qui n’ont pas connus ces classes c’étaient des classes aménagées) , je trouvais injuste qu’il n’enseigne pas dans les classes traditionnelles, j’aurai peut être eu la chance de l’avoir comme enseignant, et pour être tout à fait franche je trouvais que ces élèves de classe de transition ne méritaient pas un si bel homme.
Voilà mon expérience.
Il a un petit côté à la Pagnol que j’aime beaucoup ce texte. Surtout la petite dernière en suspension : Bravo !
> Chère Cécile, vous avez eu de la chance… Il aurait pu être plus incisif et plus troublant… à sa place, devant un public facile, aurais-je su résister au plaisir de placer « Un jour nous referons le monde à notre démesure… »? Ce qui peut avoir son petit effet sur un auditoire adolescent… Mais l’heure n’était sans doute déjà plus aux aventures à la Gabrielle Russier (tragiques, finalement…)
Venez d’où vous voulez, et passez encore par la Faune et la Flore, qui est un joli blog, mais revenez me voir… Vous êtes la bienvenue sur mes pages…
>C’est que, chère Pouchka, le transfert est à la base de bien des apprentissages… Et si un peu de douceur, de désir s’en mêlent, pourquoi les rejeter? Prudence toutefois, le moindre passage à l’acte, la moindre ambiguïté seraient intolérables…
> Pagnol? alors ça! mais je ne l’ai plus lu depuis le temps des dictées… Vous relancez un nom qui m’a échappé depuis trop longtemps… Je vais aller farfouiller dans mes cartons de livres pour voir ce que j’ai encore de lui… Merci, en tout cas, Héphémères, de votre passage… Vous aussi, revenez… Et de ce pas je retourne sur vos pages…
Cher Soluto,
hum !
A l’époque, alors âgée de 15 ans, je ne fréquentais essentiellement que des « vieux » de 18 à 20 ans. A la très grande inquiétude de mon père … … Il aurait donc été très malvenu (car cela l’aurait rendu fou) d’en rajouter avec un homme d’environ 15 ans mon aîné. Cet homme, de toutes les façons, et même s’il m’aimait bien (ce qui était « un grand honneur » puisque que je ne faisais que le « service minimum » en maths (mais j’avais tant d’autres choses à faire …)), se souciait comme d’une guigne des « petites » puisqu’il sortait avec une vraiment très jolie professeure d’italien du lycée voisin.
Cela dit, j’avais rencontré, au cours de mes études, un garçon qui, à 14 ans, s’était épris sincèrement et durablement de sa professeure de français de collège (et réciproquement). La liaison, longtemps clandestine, bien évidemment, avait été et restait très compliquée. Même une fois l’âge adulte atteint … … Outre le fait que notre société voit d’un mauvais oeil ces affaires de coeur hors normes ainsi que les femmes vivant avec des hommes bien plus jeunes, une femme abordant la cinquantaine n’a pas forcément les mêmes préoccupations, désirs et angoisses qu’un garçon de moins de trente ans. Disons qu’à 50 ans, cette femme se sentait en détresse, vieillir et sentait que son compagnon la voyait vieillir voire était tenté de regarder ailleurs … Une histoire d’amour délicate, difficile, perturbante, belle et triste, à la fois, dont ce copain parlait peu, ou en termes voilés et pudiques.
> chère Cécile, l’histoire que vous évoquez est très intéressante… Vous dites, sans doute à juste titre, qu’elle était vue d’un mauvais oeil… Imaginez ce qu’il en aurait été si les rôles avaient été inversés, si un homme de plus de vingt ans son ainé avaient une sexualité active avec une de ses élèves de quatorze ans. L’on parlerait immédiatement (et peut-être à juste titre)de relation perverse. Et d’ailleurs il faudrait y regarder de plus près, qui sait si ce n’était pas ça qui était en jeu dans leur histoire? Pourquoi les femmes seraient-elles épargnées par les pulsions pédophiles? N’y a t-il vraiment rien à explorer de ce côté là?…
Par ailleurs votre histoire nous rappelle que les relations d’attachement entre personnes d’âges trop différents (ce n’est pas une découverte) vieillissent mal en général. Qu’elles ont un prix, celui de l’ennui, de l’envie, de la lassitude, de la méfiance, de l’échappement… Comme toutes les autres? Sans doute… Mais quand la fatigue gagne sur le désir et que la vigueur redouble chez un partenaire l’avant goût de la mort est décidément trop puissant…
Au plaisir de vous revoir sur ces pages, chère Cécile…
Plusieurs jours ayant passé, je suis gênée d’avoir raconté cette histoire d’amour vraie mais vraiment délicate.
> Allons, allons, Cécile… Celui qui fait une erreur, puis qui la regrette, souffre deux fois… Vous avez su la raconter avec assez de pudeur pour que personne ne vous fasse le reproche d’avoir pillé la vie d’autrui… Ne vous inquiétez plus(je le veux!) et revenez bientôt…