Redites-moi des choses tendres
On en reparle bientôt…
8 commentaires
Quand je comprends qu’il est bien tard, que les années qu’il me reste n’en finiront plus de se jeter sur moi pour mieux m’éviter, que je sens les regrets sédimenter au fond de mon cœur, je ne suis bien que là, arrimé à ma chaise, sur mon tapis de bambou, à distance de mon chevalet d’un demi bras.
Cinq litres de white spirit en bidon sous la main gauche, mes couleurs dans leurs bacs sous la droite, l’essence et l’huile dans leurs godets, les pinceaux en bouquet dans leurs pots, le front sous la lampe et ma palette chargée sur mes genoux j’attends.
Je me débarrasse du monde comme il se débarrasse de moi.
C’est un processus, pas même une fiction.
L’impensé, à coups de lignes et de masses, s’ordonne, trouve sa cohérence, se dévoile. C’est un mouvement inquiet qui cherche son apaisement par un saisissement. Je ne veux rien sinon glisser hors de moi, guidé confusément par la vibration des couleurs, par l’ivresse d’un geste délié, d’un trait retenu. Je suis dans la pâte que j’écrase sur la trame de la toile, dans la soie du pinceau, dans la main qui porte mon désir, dans l’image qui émerge.
Je me plais là, infiniment paisible, en retrait des pensées, à camper à l’abri des mots, baigné dans la sensation intense d’être au bon endroit, au bon moment.
Ailleurs je perds mon temps.
Un jour loin de soi
Un jour monochrome, mat, plat comme un plat
Sans histoire, ni relief
Sans creux, ni bosse
Sans cri, ni couac
Un jour raide
Qui rebute et qu’on clabaude
Un jour sans faux-plis, ni faux-plat, ni faux-pas
Un triste plat du jour
D’un jour sans appétit, sans estomac,
Sans mordant, sec et dévitaminé, sans saveur,
Ni service complice, ni ferveur qu’on place
Dans rien
Un jour loin de soi
Sans sketch-book, ni bloc-notes, ni bâtons de graphite
Délivré des livres et des brosses
Alangui dans de beaux draps, sans bras blancs de femme
Sans room-service, ni café, ni jus d’orange, ni rideaux rabattus, ni contre-jour
Loin des frôlements de presque, des traitements de textes
Remuer non, rester là, serti d’ennui,
À l’abri des hommes
Éboulé, aboulique
Bailler ballant sans pitch, sans accroche, sans pêche
Petits plats dans l’écran des tablettes aux pétillants pixels
Des plans sans éclats, sans clinquant, s’évaporent
Les heures sans contours, sans attente, s’envasent,
Les appels en souffrance, les notifs et les alarmes désarmées
Les à tu et à toi et tout le tralala se taisent
On songe aux sentiments falsifiés
Sans y croire, sans y cuire, sans s’y fier
Mais aussi aux romans qui mûrissent, rancissent, se décolorent
Aux dessins qu’on avorte par la pensée
A tout ce qui ne sera pas
Saoul de térébenthine, de mots crus, de bruine, d’absence
Coffre-cœur inviolable caché dans un ourlet de chair rouge
On ne pleure, ni ne prie, ni ne plie, ni ne pense
On peine
S’en retourner à soi demain
Soluto, novembre 2017
Le 9 novembre dernier Jean-Claude Lalumière (clic) écrivait le billet que voici sur son blog :
Chaque soir, ou presque, depuis six mois maintenant, je raconte en dix lignes au moins, parfois vingt, rarement plus, la journée qui vient de s’écouler. Presque chaque soir. Même en ligne, l’exercice reste solitaire. J’ai parfois l’impression de boire tout seul au comptoir. Je suis nostalgique d’une époque où internet n’avait pas encore inventé les blogs et où l’expression y était encore collective, comme avec Antidata, avant que la revue ne deviennent maison d’édition. Pour rompre cet isolement, j’ai décidé d’ouvrir ce blog à des invités, de leur demander de raconter une journée de leur choix, Une journée particulière, inoubliable, ou au contraire banale, comme une autre, une journée imaginaire, rêvée, idéale, de cauchemar, une belle journée, de solitude ou entre ami, une journée à oublier, qui ne mérite pas d’être notée, la dernière, la prochaine, sous le soleil ou sous la pluie, à la mer, à la campagne, une journée de travail, de vacances, de farniente, de shopping, de fête ou même une nuit. A eux de voir. Leurs journées viendront s’ajouter aux miennes, sans contrainte (ils sont libres de produire ce qu’ils veulent : texte court ou long, poésie, chanson, vidéo, photos…) Une sorte d’auberge espagnole, d’atelier d’écriture, de création permanent… (…) https://jclalumiere.blogspot.fr/
Puis il m’invita à y aller de ma journée… Je vous ai donc recopié mon poème, ma participation, ma réponse à l’invitation (sorte d’Invitation au Voyage – sur place – pour ma part)…
La couverture du dernier ouvrage de Schiffter, Le charme des penseurs tristes, a tout de suite retenu mon attention. L’auteur de la photo, Nori, a su capturer, au fond d’une sorte d’entonnoir de lumière, un personnage solitaire descendant vers la mer. Un individu minuscule avançant sur une route déserte entre un château et la végétation, le masculin et le féminin, la culture, la nature… Toutes ces choses qu’on ne manque pas de projeter pour peu qu’une image somptueuse vous résiste un peu.
C’est en renonçant à examiner la photo dans le détail, et en prenant un peu de recul, que s’est levé ce pubis de lumière… Je n’ai pas pu résister. J’ai, à partir de cette photo, réalisé le montage ci-dessus.
Schiffter n’en a pas été fâché puisqu’il l’a publié sur son blog.
Vous pouvez vous lancer dans ce livre. Si d’aventure il n’était pas pour vous, vous n’y comprendriez rien et en sortiriez indemne. Mais à l’inverse, si ce texte vous trouve, il déploiera son charme et vous touchera profondément. Peut-être même durablement.
Je vous livre l’une des phrases de l’auteur que j’ai recopiée afin de ne pas la perdre trop vite « Le sentiment tragique de la vie répugne à l’esprit de sérieux, sa parodie vulgaire. »
Qui dit mieux?
http://lephilosophesansqualits.blogspot.fr/
Montage à partir de la couverture du dernier livre de Schiffter
septembre 2013
…
J’ai surtout compris que je ne vous laisserais pas filer sans tenter d’échanger quelques mots avec vous. Je voulais connaître le son de votre voix…
Je suis un pleutre. Ma gorge se serre vite, je tremble souvent, parfois je crains que mes jambes ne se dérobent. Mais je sais aussi qu’il faut être courageux quand la situation l’exige, que les plats ne repassent pas, qu’on peut se dessécher à force de regrets. Avec l’énergie du timide acculé j’ai marché vers vous. Vous me tourniez le dos. Je cherchais une phrase à vous dire, mille compliments naissaient et mouraient de ridicule dans ma tête échauffée. A mesure que je me rapprochais de vous je perdais mes moyens. C’est dans ce contexte que ce fichu chariot m’a échappé, qu’il est venu vous heurter… Quel bel acte manqué. Pardonnez-moi encore… Pour ne pas vous perdre trop vite j’ai inventé n’importe quoi… Une tâche, une ombre, un trou dans votre manteau… Il a fallu que ce gros bonhomme infâme se mêle de notre histoire au moment où je retrouvais un soupçon d’aisance pour tout fiche en l’air ! Mais peut-être suis-je injuste… Peut-être même devrais-je le remercier. Sans lui je ne serais peut-être pas là à vous raconter ces histoires qui doivent vous faire bien rire…
— Je ne ris pas ! dit-elle plus vivement qu’elle ne le voulait.
J’ai fait celui qui n’avait pas entendu et j’ai continué. Je tenais bien mon public, il fallait en profiter.
— Voilà, vous savez tout. Enfin, presque tout… Le reste n’est pas dicible. C’est un mélange de joie et d’inquiétude. La joie d’être arrivé jusqu’à vous, d’avoir su vous confier ces quelques émotions avec lesquelles il va falloir maintenant que vous vous débrouilliez. Je ne me fais pas de soucis : les femmes savent très bien ranger tout ça sous leur mouchoir. Mais aussi d’inquiétude, donc… Car je vais prendre mon taxi, rentrer boire mon champagne seul et vous perdre pour toujours…
Extrait de Glaces sans tain Ed. Le Dilettante
Tous les renseignements sur mon livre sont ici: http://www.ledilettante.com/livre-9782842637675.htm

La mer longée jusqu’à-Sainte A, la grille, la cloche et les trois marches du perron. La porte gris perle, la salle d’attente comme un refuge. Treize années de rendez-vous. Toujours le jeudi, toujours à dix-sept heures et vingt-cinq minutes, exceptés six semaines dans l’année, deux l’hiver, quatre l’été. Mes rendez-vous manquants calés sur ses congés. Le distributeur de la Société Générale de la place des Halles, les billets retirés, pliés, glissés dans la poche arrière droite de mon jean, bientôt dans sa paume. Colère, reconnaissance, c’était selon. Ses ongles vernis repliés sur mes heures de travail devenues abstraites.
Salle d’attente donc. Papier peint bleu pastel, fauteuil unique, en rotin, défraichi. Au mur, à gauche, un poster alignait des dessins de nœuds marins, à droite une petite vitrine présentait, épinglés, ces mêmes nœuds fabriqués en cordelette. Chacun d’entre eux était souligné d’une étiquette avec un nom (nœud de vache, nœud de galère, nœud de Carrick, nœud de cul-de-porc, nœud de tête-de-Maure… Je me souviens de presque tous…). Par terre traînaient des livres pour enfants.
Elle venait me chercher, un élastique ou un bout de ficelle en main. Avec à chaque fois le même sourire, la même sollicitude et une même distance. Je m’allongeais sur le divan damassé, rouge et or, après avoir retiré mes chaussures et mes chaussettes car j’ai toujours aimé avoir les pieds nus.

Parler. Etre dans sa parole. L’habiter enfin.
Des mots, des mots perdus, éperdus, insensés. Des phrases mortes, dites par d’autres, déposées dans ma bouche. Des étrangetés moisies qui ne me ressemblent pas. Le vertige des failles entrevues. Des rêves dévidés. Des bribes mal couturées. Ses interventions, toutes vécues sur le mode de la violence et du doute. Que sait-elle que je ne sache ? Que tais-je qu’elle contienne encore mieux que moi ? Mais aussi ses gros sabots, toute sa morgue, ses poses (le feulement de ses collants quand elle croisait ou décroisait les jambes derrière moi) et sa suffisance. Sa traque. Ses tentatives de levée de pensées prétendument incestueuses, mes hypothétiques pulsions meurtrières. Mes ricanements.
Flash. Un jour je me redresse sur le divan, me retourne vers elle, mets mes mains grandes ouvertes en renfort de mes oreilles et, saisi d’une inspiration, lui fais le lapin de Chantal Goya en la regardant droit dans les yeux. Pour voir, donc. « Vous ne pouviez pas ne pas le faire. » Sans doute.
Assez joué. Raccourcissement du temps des séances et augmentation de leur coût. Pour que « je me mette au travail »… J’aurais dû rire. Mais mon assujettissement, mes allégeances… Mon investissement et mon énergie me privaient de tout esprit critique. Les séminaires, les lectures impossibles, la théologie lacanienne et l’angoisse, obstinément là… Mon addiction aux séances, ma soumission, la montée en puissance du dégoût. La souffrance de l’emprise.
Me reviennent deux anecdotes qui se répondent. La première en début de cure. Je lui offre le journal de Michel Leiris. « Ici on ne s’attire pas de bonnes grâces par des offrandes » me dit-elle. Elle refuse même de toucher le paquet cadeau que j’avais fait faire à la Galerne et ne saura jamais ce que je lui destinais. C’était bien répondu. Douze ans plus tard je me trompe dans le paiement d’une séance. Un billet de cinquante euros s’est glissé dans les billets de vingt. « Vous vous trompez d’endroit! Ici le « petit cadeau » n’est pas de mise » Elle est risible. Enfin risible! Je veux finir la cure. « C’est dommage, ça commençait à bouger… » me dira-t-elle.
Dernière séance. Je me fais plaisir. Je m’approche d’elle et je l’embrasse. « Oh ! s’écrie-t-elle, un réel » Elle ne recule pas.
C’était il y a longtemps. Tout ça me parait bien loin, confus comme un songe. Je ne comprends plus rien à mes peurs passées, à toute cette servitude volontaire. Aperçu récemment sur la promenade de la plage je suis allé au devant d’elle en souriant. C’était la première fois que je la revoyais. Elle, qui me semblait naguère hors du temps, m’a paru vieille et définitivement sortie du champ du désir. Nous avons parlé un peu. J’ai voulu savoir si je pouvais dessiner et écrire sur la cure. Elle m’a répondu avec indifférence que je l’avais payée et qu’elle m’appartenait. Son désengagement m’a contrarié. Par une curieuse association je me suis alors demandé si elle avait gardé sa passion pour les nœuds. En tout cas, elle en avait toujours la tête… Enfin, ce n’est pas ce que je voulais dire…
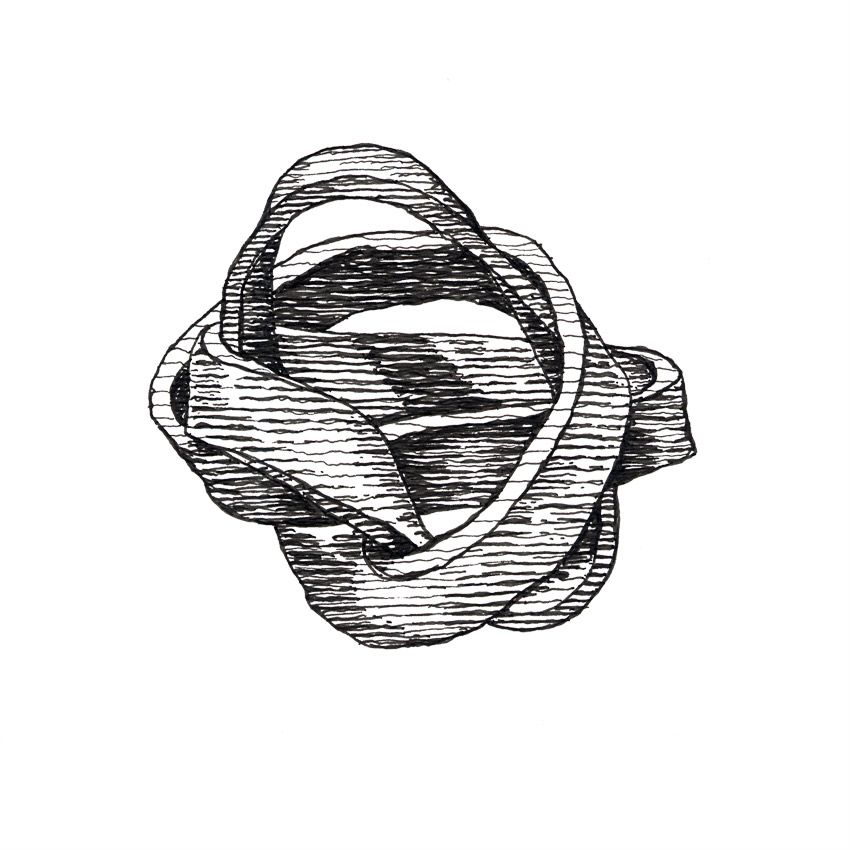

Ça n’enchantait plus personne de faire un détour pour aller les chercher, les trois frangines. Tout le monde ne court pas après ce genre de courses. J’ai des collègues qui répugnent à faire dans le moyen trajet, surtout maintenant qu’on peut plus bricoler les compteurs. Moi, j’ai pas les moyens de chipoter sur le boulot, j’ai encore des kilomètres à faire pour amortir la licence. On m’avait prévenu au central qu’elles n’étaient pas commodes mais, bonne pomme, je m’y étais collé, sans doute un peu naïvement. Seulement voilà, dans cette campagne cauchoise où tous les chemins se ressemblent par pluie battante je m’étais perdu en route. Pas beaucoup, remarquez ! Mais bon, j’avais, j’avoue, ma petite demi-heure de retard…
Quand je me suis garé le long de leur foutue longère, les trois grâces, qu’on aurait dit plantée là depuis des lustres, m’ont jeté un œil noir ! Si noir que ça m’a foutu les foies ! Et j’ai bien cru qu’elles allaient me buter quand elles se sont approchées du bahut… Pendant tout le trajet qui nous emmenait à Bonne-Nouvelle, où le fils d’une des teigneuses était incarcéré, elles m’ont pas dégoisé un mot… Toutes les trois à l’arrière, le sac sur les genoux, en regardant droit devant elles, elles chuchotaient. On aurait dit qu’elles préparaient un casse de PMU dans une rue passante. Quand je croisais leur regard dans le rétro je me sentais en faute. J’avais même la trouille d’être mouillé malgré moi dans leurs drôles de combines. Pour me distraire j’ai voulu mettre des chansons nostalgiques à la radio mais la plus vioque a dit « ferme ton zinzin et regarde la route… » J’ai plus moufté.
A Rouen je les ai déposées devant la grande lourde noire de la Maison d’Arrêt. Celle qui n’aimait pas la musique a dit « Tu reviens nous chercher dans une plombe. Précise. Tu ne recommences pas tes fantaisies ! » Je les ai laissées sur le trottoir à côté de femmes plus jeunes qui leur adressèrent aussitôt la parole. Elles attendaient toutes leur temps de parloir…
J’ai même pas osé m’éloigner du quartier (une heure ça passe vite) de peur qu’elles me foutent un contrat sur la tronche, ou qu’elles bavent à leur progéniture à propos de mes manquements horaires. Alors je suis allé siffler une paire de mousses dans un bar voisin appelé ironiquement Le Violon. J’ai aussi fait cinq morpions et deux Vegas. J’ai paumé. C’était décidément pas mon jour…
Alors que j’arrivais à l’heure dite, elles jaillissaient sur le trottoir de la prison et fonçaient déjà sur le bahut. « On a failli attendre !» a dit l’une, « En voiture Simone… » a fait l’autre, « Il tiendra ! » a lâché la troisième. Elles étaient ragaillardies mes trois vieilles. Elles lui avaient trouvé bonne mine et de l’éclat dans l’œil! Il était aussi question de « redresser sa bonne femme, une donneuse, une morue, qui faisait un peu trop sa suceuse avec les Schmidt!… » J’ai cru comprendre que la môme avait suspendu sans prévenir ses visites, mais, bien sûr, je n’ai pas demandé de précisions… Je me suis contenté d’avoir l’oreille flottante…
Puis, sans crier gare, il a été question des Chiffres et des Lettres. J’ai saisi l’allusion et j’ai écrasé le champignon au mépris des limitations de vitesse. Comme quoi on devient vite hors-la-loi… Mais je crois en effet qu’elles n’auraient pas toléré de rater le début de leur émission favorite…

Tu ne m’échapperas pas. Je resterai à côté de toi et je te surveillerai. Quand tu lèveras la tête tu rencontreras mon regard. Quand tu la détourneras je serai dans toutes tes pensées. Ainsi je pèserais beaucoup dans chacun de tes choix. Tes choix ? Ils me seront soumis. Sans mon agrément ils ne seront que des vœux insatisfaits. Tu me bouderas et je te sourirai. Tu me parleras et je t’écouterais. Pour chaque question que tu poseras j’aurai
Récapitulons encore…

C’était devenu une hantise la pause de dix heures trente. J’étais à peine installé dans la salle de repos que j’étais sûr de la voir se pointer. J’avais fini par renoncer à feinter car quoi que je fasse, que j’arrive un quart d’heure avant ou une demie heure après, elle m’y rejoignait toujours. Son œil triste, sa moue constante, ses épaules en accent circonflexe, pour peu que je m’y attarde une demie seconde, me filaient le bourdon. J’évitais son regard avec soin tandis qu’elle guettait le mien inlassablement. Nous n’échangions pratiquement rien. Je m’arrangeais pour clore toutes les conversations. Il y avait six mois que cette histoire pourtant s’était achevée. Du moins pour moi. Et quelle pauvre histoire… Quelques coucheries à l’arrache, très convenues, au bout d’un baratin médiocre que j’avais déroulé avec la conviction d’un mauvais acteur de théâtre. Des banalités qui avaient pris toute la place dans son grand vide affectif. Après quelques orgasmes tièdes j’avais senti que le sujet était épuisé. Je lui avais dit avec douceur que notre aventure n’était pas viable mais elle n’avait pas voulu l’entendre. Elle m’avait un peu enquiquiné au téléphone mais elle était tombée une fois ou deux sur ma femme et n’avoir su que dire. Elle avait fini par tourner sa rancœur contre elle-même.
Un matin, je ne sais pas, pour jouer peut-être, avant d’aller en salle de pause je suis allé
En passant devant le bureau de Nathalia je suis entré vite fait. Puisque je n’avais pas encore écoulé tout mon temps de pause je lui ai raconté l’anecdote. Je savais qu’elle allait apprécier car elle m’avait souvent taquiné sur les « yeux de crapaud mort d’amour » de mon ancienne conquête. Elle m’a mis un petit coup de poing sur le menton puis m’a caressé la joue. « toujours partant pour ce soir ? » m’a-t-elle demandé. Et je me suis entendu lui répondre « plus que jamais Nathalia, plus que jamais… »
Trois petites histoires de gobelets…

Je serai la première à écouter vos choses tendres…
¸¸.•*¨*• ☆
Ah, Célestine, chaque page vous en murmurera de nouvelles… A très bientôt alors. J’espère que vous me ferez un petit retour de lecture 😉
Bonjour Soluto , Félicitations depuis le temps que tu en parlais . Hâte de le découvrir . Bises
Hello Cegaflo, je suis heureux de voir que tu passes de temps en temps par ce blog ! Il y a si longtemps qu’on ne s’est pas vus. A mon avis j’ai dû te parler d’autres projets anciens ; de celui-ci sans doute pas… Je t’embrasse, à bientôt…
Voilà qui est fait j’ai précommandé » Redites moi des choses douces » et je me ferai le plaisir d’aller le chercher en librairie .
Un grand merci chère Cécile ! Je te souhaite une belle et bonne lecture… A très bientôt…
Ça y est nous sommes le 06 septembre ! Bonne chance à « Redites mois des choses tendres » . Journée importante pour toi ,, palpitations , exaltation, attente … ? A très bientôt , mes pensées vont vers toi aujourd’hui . A très bientôt, je t’embrasse .
Je te réponds avec un peu de retard. Ce 6 septembre fut une belle journée parisienne… A très bientôt…